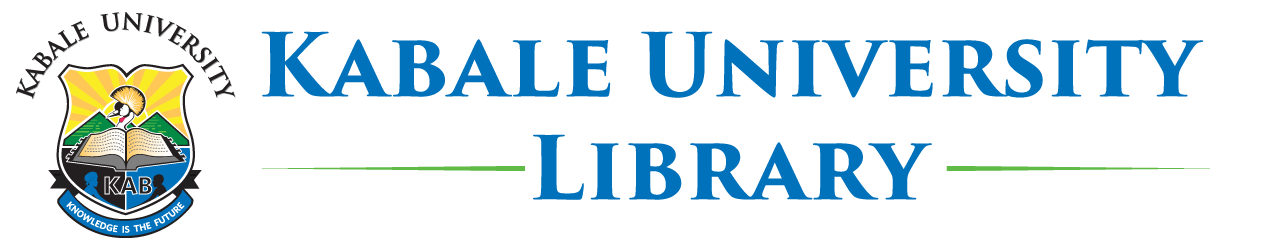« Nous sommes les gardiens du Paradis » : maîtrise des ressources et autonomie alimentaire à Rapa (archipel des Australes, Polynésie française)
L’isolement de l’île de Rapa et la volonté de sa population d’en préserver les ressources propres, terrestres comme maritimes, pour en faire le support d’interactions sociales intenses, font de la sobriété partagée un mode de vie à même d’en assurer la pérennité, à travers la réalisation d’une utopi...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fra |
| Published: |
INRS - Centre Urbanisation Culture Société
2024-01-01
|
| Series: | Lien Social et Politiques |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://doi.org/10.7202/1115796ar |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | L’isolement de l’île de Rapa et la volonté de sa population d’en préserver les ressources propres, terrestres comme maritimes, pour en faire le support d’interactions sociales intenses, font de la sobriété partagée un mode de vie à même d’en assurer la pérennité, à travers la réalisation d’une utopie communautaire rurale concrétisée autour d’un projet partagé de souveraineté alimentaire par la mise en oeuvre d’une communauté intentionnelle de vie (Tönnies, 1977 ; Lallement, 2019). Ce projet s’appuie sur la maîtrise des ressources alimentaires, et s’illustre sur le terrain par un fort taux d’autoproduction alimentaire, et un système alimentaire largement collectif (Serra-Mallol, 2018), faisant de Rapa une modalité de la communauté intentionnelle de type sociétaire.La communauté de Rapa a su mettre en oeuvre une utopie concrète et réaliste (Bregman, 2017) en préservant au travail son statut d’oeuvre émancipatrice (Arendt, 1983). La vie quotidienne y est rythmée par une sociabilité différente faite d’entraide, d’échanges spontanés de services, autour de valeurs partagées d’égalité et de solidarité. Cet exemple de communauté intentionnelle pose la question du statut des modalités de relations et d’interactions entre les humains et avec leur environnement, ainsi que celle des dispositifs axiologiques de la recherche d’un bien-vivre individuel et collectif, d’une « vie bonne » (Taylor, 1998 ; Rosa, 2018), basée sur une sobriété volontaire pour préserver un modèle en opposition à un modèle « extérieur » subi perçu comme source d’inégalités sociales et économiques. |
|---|---|
| ISSN: | 1204-3206 1703-9665 |